
La résiliation d’un cautionnement bancaire semble marquer la fin d’un engagement anxiogène. Pourtant, cette démarche administrative ne suffit pas à effacer toutes vos obligations. Entre l’acte de résiliation et l’état réel de libération s’installe un décalage temporel que la plupart des cautions méconnaissent totalement.
Cette méconnaissance peut coûter cher. Face aux 67 830 procédures de défaillances d’entreprises enregistrées en 2024, les banques activent massivement les garanties existantes. Une caution qui pense avoir résilié son engagement découvre parfois, des mois plus tard, qu’elle reste poursuivie pour des créances qu’elle croyait éteintes. La résiliation du cautionnement solidaire n’opère qu’un effet partiel, limité aux obligations futures, laissant subsister une zone de vulnérabilité juridique rarement explicitée.
Comprendre cette distinction fondamentale permet de passer d’une illusion de libération immédiate à une maîtrise juridique complète de votre situation. Il ne s’agit pas seulement de savoir comment résilier, mais de sécuriser définitivement votre sortie en identifiant précisément ce qui reste exigible et en documentant votre libération pour les obligations éteintes.
Les clés de votre libération effective
Résiliation et libération constituent deux réalités juridiques distinctes, créant un décalage temporel dangereux. Votre engagement prend fin pour les créances futures, mais subsiste intégralement pour toutes les dettes nées avant la date de résiliation. Cette zone de vulnérabilité exige une cartographie précise de vos obligations résiduelles et une sécurisation documentaire systématique. Sans ces garanties, vous restez exposé à des réclamations bancaires portant sur des montants parfois considérables, même plusieurs années après votre démarche.
- La résiliation éteint uniquement vos obligations futures, pas les créances déjà constituées
- Les vices de forme ou de fond peuvent invalider totalement votre résiliation
- Capital, intérêts et accessoires antérieurs restent intégralement exigibles
- L’obtention d’un décompte contradictoire et d’une mainlevée formelle sécurise votre position
Comprendre le décalage entre résiliation et libération effective
La confusion entre résiliation et libération constitue le premier piège juridique. La résiliation désigne un acte juridique formel par lequel la caution manifeste sa volonté de mettre fin à son engagement. La libération, elle, caractérise un état de fait : l’absence totale d’obligations exigibles à votre encontre. Ces deux réalités ne coïncident jamais temporellement.
Le droit bancaire applique ici un principe de photographie juridique. Au moment précis où votre lettre de résiliation prend effet, l’ensemble des créances existantes restent figées dans le périmètre de votre engagement. Tout ce qui existe avant ce moment demeure exigible. Tout ce qui naîtra après devient inaccessible au créancier. Cette césure temporelle crée une zone de vulnérabilité dont la durée dépend directement de la santé financière du débiteur principal.
La distinction fondamentale oppose les créances nées aux créances futures. Une créance née correspond à une dette déjà constituée juridiquement, même si elle n’est pas encore exigible. Une créance future, inversement, n’existe pas encore au moment de la résiliation. Prenons un prêt professionnel remboursable sur cinq ans. Si vous résiliez votre cautionnement après deux ans, les trois années restantes constituent des créances futures, théoriquement éteintes par votre résiliation.
Pourtant, le cas particulier des prêts à échéances multiples inverse cette logique apparente. Comme le précise le cadre juridique, la caution reste tenue du remboursement des prêts à échéance à durée déterminée conclus antérieurement à la date d’effet de la résiliation du cautionnement. Cette formulation signifie qu’un prêt contracté avant votre résiliation continue de bénéficier de votre garantie pour toutes ses échéances, y compris futures. Votre résiliation ne libère alors que des prêts non encore souscrits par le débiteur.
Cette réalité juridique explique pourquoi certaines cautions reçoivent des réclamations plusieurs années après avoir résilié leur engagement. Le prêt garanti poursuit son échéancier normal, et chaque défaillance du débiteur active votre responsabilité sur les mensualités impayées, même si elles se produisent longtemps après votre démarche de résiliation.
La temporalité juridique du cautionnement bancaire révèle ainsi sa complexité fondamentale. Entre l’instant où vous envoyez votre lettre recommandée et le moment où vous êtes effectivement libéré de toute obligation, s’écoule une période dont la durée reste imprévisible. Elle dépend du remboursement intégral du prêt garanti ou de la survenance d’un événement extinctif comme la liquidation judiciaire du débiteur.
Ce décalage temporel impose une vigilance constante. Vous devez identifier précisément quelles obligations subsistent dans votre périmètre de responsabilité et lesquelles ont été effectivement éteintes par votre résiliation. Sans cette cartographie, vous naviguez à l’aveugle, incapable de distinguer une réclamation légitime d’une demande abusive.
| Type d’engagement | Avant résiliation | Après résiliation |
|---|---|---|
| Créances déjà nées | Exigibles | Restent exigibles |
| Créances futures | Couvertes | Non couvertes |
| Prêts en cours | Garantis intégralement | Échéances futures garanties |
Le calendrier juridique de votre cautionnement ne suit pas une logique linéaire simple. Il se construit sur une superposition de temporalités : celle du contrat de prêt principal, celle de votre engagement de caution, celle de votre résiliation, et celle des défaillances éventuelles du débiteur. Chaque événement s’inscrit dans cette chronologie complexe et détermine le périmètre exact de vos obligations résiduelles.

Cette complexité temporelle justifie l’accompagnement juridique lors d’une résiliation de cautionnement. Un professionnel identifie immédiatement les créances qui persistent dans votre périmètre et celles dont vous êtes définitivement libéré. Il établit la photographie juridique exacte de votre situation au moment de la résiliation, document qui servira de référence en cas de contestation ultérieure.
Détecter les vices qui invalideraient votre résiliation
Une résiliation juridiquement inefficace produit un effet dévastateur : elle vous laisse croire que vous êtes partiellement libéré alors que votre engagement reste intégralement actif. Les vices qui invalident une résiliation se répartissent en deux catégories distinctes : les vices de forme liés à la procédure de notification, et les vices de fond liés à la nature même de votre cautionnement.
Les erreurs de notification constituent le premier facteur d’invalidation. L’envoi de votre lettre de résiliation au mauvais destinataire annule totalement la démarche. Le service contentieux de l’agence locale ne constitue pas le destinataire légal si le siège social de la banque se trouve ailleurs. L’absence d’accusé de réception vous prive de toute preuve de date certaine, élément pourtant crucial pour déterminer le périmètre des créances couvertes. Le non-respect des délais contractuels de préavis, lorsqu’ils sont stipulés dans l’acte initial, rend la résiliation prématurée et donc inopposable.
Certains cautionnements excluent par nature toute faculté de résiliation. Les cautionnements à première demande, par lesquels vous vous engagez à payer sur simple réclamation sans pouvoir invoquer les exceptions tirées du contrat principal, comportent généralement une durée déterminée incompressible. Les cautionnements professionnels, souscrits dans le cadre d’une activité commerciale, suivent des règles distinctes du régime protecteur applicable aux particuliers. Les engagements qualifiés d’irrévocables dans leur formulation initiale ne peuvent être résiliés unilatéralement, sauf clause expresse contraire.
Le vice originel le plus fréquent concerne la mention manuscrite obligatoire. Comme l’explique un spécialiste de la défense des cautions, l’absence ou l’inexactitude de la mention manuscrite obligatoire lors de la signature initiale rend l’acte de cautionnement nul. Cette nullité affecte l’ensemble de votre engagement, y compris toute tentative ultérieure de résiliation. Un cautionnement nul n’a jamais existé juridiquement, rendant la question de sa résiliation sans objet. Paradoxalement, cette nullité vous libère totalement, mais nécessite une action en justice pour être constatée et opposée au créancier.
Le piège des avenants et renouvellements de prêt mérite une attention particulière. Lorsque le débiteur principal obtient un rééchelonnement, une consolidation de dettes ou un nouveau prêt pendant la durée de votre cautionnement, la banque peut considérer que vous avez tacitement accepté de cautionner cette nouvelle opération. Cette requalification transforme votre résiliation antérieure en acte sans portée : vous avez résilié l’ancien cautionnement, mais un nouveau s’est substitué automatiquement. La jurisprudence exige normalement votre consentement exprès à ce nouveau cautionnement, mais les pratiques bancaires contournent parfois cette exigence par des clauses générales d’extension insérées dans l’acte initial.
L’absence ou l’inexactitude de la mention manuscrite obligatoire lors de la signature initiale rend l’acte de cautionnement nul
– Maître Anthony Bem, Cabinet Bem – Défense des cautions
La détection précoce de ces vices détermine votre stratégie juridique. Si votre résiliation présente un vice de forme, vous pouvez la régulariser en renouvelant la notification selon les formes appropriées. Si votre cautionnement présente un vice de fond, vous devez envisager une action en nullité plutôt qu’une simple résiliation. Si des avenants ont créé de nouveaux engagements, vous devez les identifier et les résilier séparément.
Points de vigilance pour une résiliation valide
- Vérifier la présence de la faculté de résiliation dans l’acte initial
- Respecter le délai de préavis contractuel stipulé
- Envoyer la lettre recommandée au bon destinataire (adresse du siège)
- Conserver l’accusé de réception signé comme preuve
L’efficacité juridique de votre résiliation conditionne l’ensemble de votre stratégie de libération. Une résiliation invalide maintient votre engagement total, transformant votre sentiment de sécurité en vulnérabilité maximale. Cette situation explique pourquoi certaines cautions découvrent, lors d’une mise en demeure bancaire, que leur résiliation n’a produit aucun effet.
Annulation d’un cautionnement de 520 000€
En avril 2022, le Tribunal judiciaire de Caen a annulé un cautionnement de 520 000€ du Crédit du Nord pour vice de forme. La banque n’avait pas respecté les obligations d’information annuelle de la caution, rendant l’engagement inopposable.
Cette décision judiciaire illustre l’importance des obligations d’information qui pèsent sur le créancier. Le non-respect de ces obligations peut vicier l’ensemble du cautionnement, au-delà de la seule question de la résiliation. Chaque année, avant le 31 mars, la banque doit vous communiquer le montant du capital restant dû et des intérêts. L’absence de cette information pendant plusieurs années consécutives peut constituer un manquement suffisant pour obtenir la décharge totale de votre engagement.
| Type de cautionnement | Résiliation possible | Conditions |
|---|---|---|
| Durée indéterminée | Oui | À tout moment avec préavis |
| Durée déterminée | Non | Attendre le terme |
| Cautionnement professionnel | Rarement | Clauses spécifiques requises |
Identifier précisément les dettes qui restent à votre charge
Une fois votre résiliation validée, la cartographie exacte de vos obligations résiduelles devient l’enjeu central. La formule générique selon laquelle vous restez tenu des dettes antérieures masque une réalité juridique bien plus complexe. Ces dettes se décomposent en plusieurs strates dont les régimes juridiques diffèrent sensiblement.
Le capital restant dû à la date exacte de prise d’effet de votre résiliation constitue le socle de vos obligations. Ce montant correspond au solde du prêt principal non encore remboursé par le débiteur. Sa détermination exige une précision absolue : un jour d’écart dans la date de référence peut modifier substantiellement le périmètre de votre responsabilité. Le capital inclut également les échéances impayées antérieures à la résiliation, même si la banque ne vous les a pas encore réclamées.
Les intérêts courus jusqu’à la résiliation se divisent en deux catégories aux implications distinctes. Les intérêts conventionnels, prévus au taux normal du prêt, s’appliquent tant que le débiteur respecte son échéancier. Leur calcul suit une méthode proportionnelle au temps écoulé. Les intérêts de retard, majorés selon un taux pénalisant, ne démarrent qu’en cas de défaillance caractérisée du débiteur. Leur calcul différencié commence à la date du premier incident de paiement, pas à celle de votre résiliation. Cette distinction a son importance : vous pouvez contester des intérêts de retard si la banque ne vous a pas informé de la défaillance dans les délais légaux.
Les frais et accessoires de la dette représentent la troisième strate de vos obligations résiduelles. Pénalités contractuelles, frais de dossier, commissions de gestion, tous ces éléments accessoires s’ajoutent au principal, mais uniquement pour ceux nés avant la résiliation. Un frais de recouvrement engagé par la banque après votre résiliation pour une créance postérieure ne peut vous être opposé. La date de naissance du frais, pas celle de sa facturation, détermine son inclusion dans votre périmètre résiduel.
La zone grise juridique apparaît avec les créances conditionnelles ou en cours de formation au moment de la résiliation. Imaginez un débiteur qui cesse de payer ses échéances deux mois après votre résiliation. Les mensualités impayées concernent-elles des échéances postérieures à votre résiliation, donc théoriquement hors de votre périmètre, ou bien s’agit-il de créances nées avant votre résiliation mais dont la défaillance n’a été constatée qu’après ? La qualification juridique de cette situation détermine votre responsabilité.
Le régime protecteur applicable aux particuliers impose à la banque une obligation d’information annuelle stricte. Comme le rappelle le cadre réglementaire, chaque année, avant le 31 mars, le créancier professionnel doit faire connaître à toute caution le montant du principal de la dette et des intérêts restant dus. Cette obligation ne disparaît pas après votre résiliation tant que subsistent des créances résiduelles. Le non-respect de cette obligation vous permet de refuser le paiement des pénalités et intérêts de retard pour la période non couverte par l’information.
La détermination du périmètre exact de vos dettes résiduelles nécessite un décompte contradictoire avec la banque. Ce document doit mentionner la date de référence, le capital restant dû à cette date, le détail des intérêts conventionnels et de retard, la liste des frais et accessoires, et la qualification juridique de chaque créance. Sans ce décompte formalisé, vous restez dans l’incertitude quant à l’étendue réelle de votre engagement résiduel.
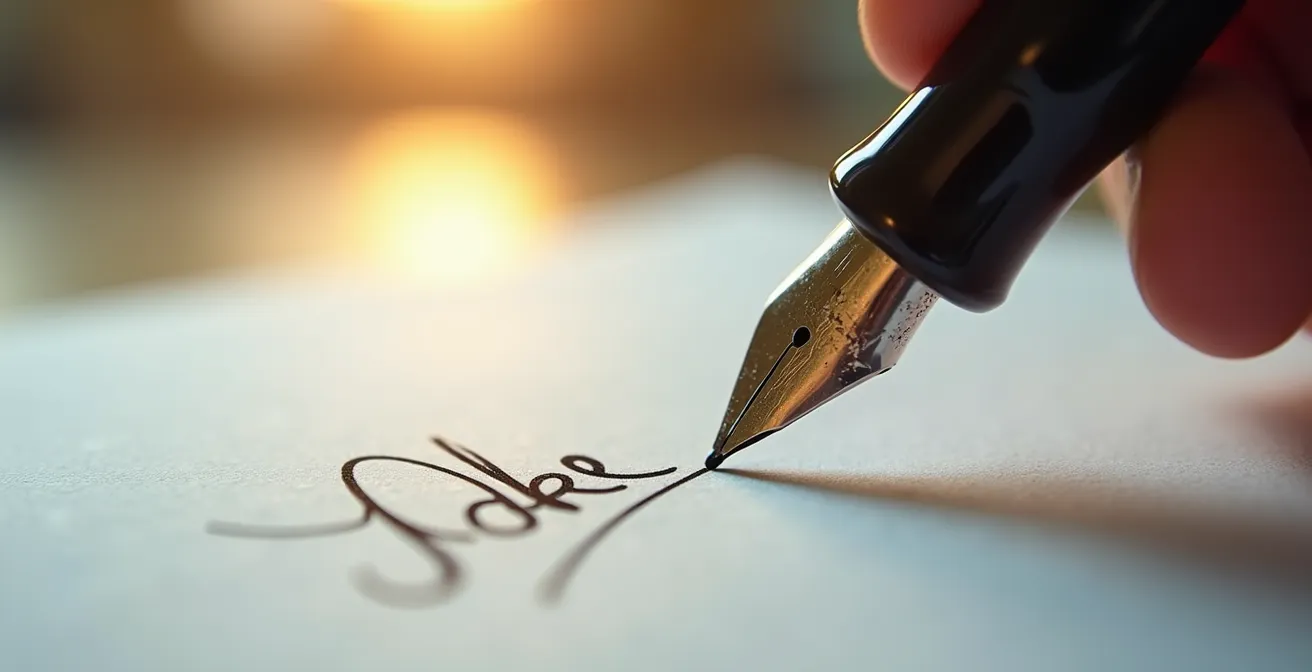
L’anatomie de vos obligations résiduelles révèle que la résiliation n’opère qu’un effet partiel et prospectif. Elle ne fait pas disparaître le passé, elle empêche seulement l’accumulation de nouvelles dettes. Cette réalité impose une gestion active de la période de transition entre votre résiliation et votre libération totale, période dont la durée dépend entièrement du comportement du débiteur principal et de sa capacité à honorer le prêt garanti.
| Type de créance | Montant moyen | Délai moyen de règlement |
|---|---|---|
| Capital restant dû | Variable selon prêt | Immédiat |
| Intérêts de retard | +2% à +5% du capital | 30-60 jours |
| Frais et pénalités | 500€ à 2000€ | 90 jours |
Cette cartographie détaillée de vos obligations vous permet de distinguer immédiatement une réclamation légitime d’une demande abusive. Elle constitue le fondement de toute négociation avec la banque et l’outil indispensable pour sécuriser juridiquement votre statut de caution partiellement libérée.
Sécuriser juridiquement votre statut de caution libérée
La démarche de résiliation ne suffit pas à garantir votre protection juridique. Entre l’envoi de votre lettre et votre libération totale s’ouvre une période de vulnérabilité pendant laquelle vous devez construire activement votre dossier de preuves. Cette sécurisation documentaire transforme une position défensive en stratégie anticipative.
L’accusé de réception de votre lettre de résiliation constitue le premier élément probatoire essentiel. Ce document établit la date certaine de prise d’effet de votre résiliation, point de référence absolu pour déterminer le périmètre des créances couvertes. Conservez-le dans un dossier physique et numérique distinct, avec copie de la lettre envoyée. En cas de contentieux, la banque ne pourra contester ni la réalité de votre démarche ni sa date d’effet.
Le décompte détaillé des sommes encore exigibles doit être exigé formellement auprès de la banque. Cette demande s’effectue par lettre recommandée adressée au service contentieux, avec mise en demeure de répondre sous quinze jours. Le décompte doit préciser la date butoir retenue, le capital restant dû à cette date, le détail ligne par ligne des intérêts et accessoires, et la projection des échéances futures du prêt garanti si celui-ci poursuit son cours normal. Ce document contractualise le périmètre de votre responsabilité résiduelle et interdit à la banque de vous réclamer ultérieurement des sommes non mentionnées.
La mainlevée de cautionnement ou l’attestation formelle de libération représente le graal de votre démarche. Si le prêt principal a été intégralement remboursé par le débiteur, vous pouvez exiger une attestation de libération totale constatant l’extinction définitive de toutes vos obligations. Si le prêt se poursuit mais que vous avez valablement résilié votre engagement pour l’avenir, demandez une attestation de libération partielle précisant que vous ne garantissez plus les créances postérieures à la date de résiliation. Ces documents possèdent une valeur juridique opposable en cas de réclamation ultérieure.
L’inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) peut persister même après résiliation de votre cautionnement. Consultez votre situation auprès de la Banque de France en exerçant votre droit d’accès. Si le prêt principal est intégralement remboursé et que vos obligations résiduelles sont soldées, demandez formellement la radiation de cette inscription. Le maintien abusif au FICP après libération totale constitue un préjudice indemnisable.
Cette démarche de sécurisation suit une logique d’escalade progressive. Vous commencez par obtenir les preuves formelles de votre résiliation, puis vous documentez le périmètre exact de vos obligations résiduelles, ensuite vous obtenez la reconnaissance écrite de votre libération partielle ou totale, et enfin vous nettoyez les traces administratives de votre engagement dans les fichiers bancaires.
Démarches de sécurisation post-résiliation
- Étape 1 : Conserver l’accusé de réception de la lettre de résiliation
- Étape 2 : Demander un décompte détaillé des sommes restant dues
- Étape 3 : Obtenir une attestation de mainlevée partielle ou totale
- Étape 4 : Vérifier votre inscription FICP et demander radiation si nécessaire
- Étape 5 : Constituer un dossier complet avec tous les justificatifs
L’accompagnement juridique prend tout son sens dans cette phase de consolidation. Un professionnel identifie immédiatement les documents manquants dans votre dossier et les demandes formelles à adresser à la banque. Il rédige les courriers de mise en demeure avec les fondements juridiques appropriés et les délais légaux applicables. Il négocie avec la banque l’obtention des attestations de libération et vérifie leur formulation pour éviter toute clause ambiguë qui maintiendrait subrepticement une partie de votre engagement. Vous pouvez vous faire accompagner juridiquement tout au long de cette démarche pour maximiser vos chances d’obtenir une libération complète et documentée.
La jurisprudence illustre l’importance de cette sécurisation documentaire. Un gérant de SCI a obtenu la libération de sa caution bancaire de 91 469€ après refus de renouvellement du bail commercial. La Cour d’appel a confirmé que le cautionnement cessait automatiquement en cas de résiliation du bail principal, malgré l’occupation sans droit des locaux par le locataire. Cette décision démontre que la qualification juridique exacte de votre situation détermine l’étendue de votre libération, au-delà des apparences factuelles.

La constitution d’un dossier complet de preuves vous positionne en situation de force lors de toute négociation ou contentieux ultérieur. Vous n’êtes plus dans l’incertitude anxiogène, mais dans la maîtrise documentée de votre situation juridique. Cette position permet d’identifier immédiatement les réclamations abusives et de les contester avec les fondements appropriés.
Contester les réclamations bancaires injustifiées
Une fois votre statut sécurisé, la vigilance reste nécessaire face aux demandes de paiement de la banque. Le contexte économique actuel multiplie les réclamations : face à une augmentation de 35% des défaillances d’entreprises en France en 2023, les établissements bancaires activent systématiquement toutes les garanties disponibles. Cette pression financière génère parfois des réclamations qui dépassent le périmètre légal de vos obligations résiduelles.
L’identification des réclamations illégitimes constitue le premier niveau de défense. Toute demande portant sur des créances postérieures à la date de résiliation doit être immédiatement contestée. Ces créances sont totalement éteintes dans votre périmètre, quelle que soit leur nature ou leur montant. La banque ne peut invoquer ni l’unité du prêt garanti, ni la solidarité de votre engagement, ni aucune clause générale pour étendre votre responsabilité au-delà de la césure temporelle créée par votre résiliation.
La prescription constitue votre deuxième ligne de défense face aux créances anciennes. En matière bancaire, le délai de prescription s’établit à cinq ans à compter de la première défaillance du débiteur. Une créance non réclamée dans ce délai devient juridiquement irrecevable. La banque doit avoir formellement mis en demeure le débiteur principal, puis vous avoir informé de cette défaillance et réclamé le paiement dans les délais légaux. L’absence de l’une de ces étapes permet d’opposer la prescription, même si la créance elle-même reste techniquement dans votre périmètre résiduel.
La mise en demeure contradictoire inverse le rapport de force avec la banque. Face à une réclamation que vous estimez contestable, adressez une mise en demeure exigeant la justification détaillée de chaque créance invoquée : date de naissance, qualification juridique, montant du principal, calcul des intérêts et accessoires, chronologie des mises en demeure adressées au débiteur, justification de votre information annuelle. Cette exigence de transparence met souvent en évidence des approximations ou des erreurs dans le calcul de la banque.
Le cadre jurisprudentiel renforce votre position. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 1er mars 2023 que si le créancier ne se conforme pas à l’obligation d’information sous un mois, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. Cette jurisprudence transforme le non-respect des obligations d’information en moyen de défense direct contre les accessoires de la dette, réduisant substantiellement le montant exigible.
L’escalade vers le médiateur bancaire représente l’étape intermédiaire avant le contentieux judiciaire. Les médiateurs de l’AFUB ou de la FBF traitent gratuitement les litiges entre particuliers et établissements bancaires. Leur intervention permet souvent de débloquer une situation figée, la banque acceptant un compromis qu’elle refusait dans le cadre d’une négociation directe. Le recours au médiateur suspend les poursuites pendant l’instruction du dossier, vous offrant un répit temporel précieux.
Le contentieux judiciaire constitue l’ultime recours si les réclamations persistent malgré vos preuves de résiliation et vos contestations motivées. L’action en justice permet de faire constater par un tribunal l’extinction de certaines créances, la nullité de votre cautionnement pour vice de forme, ou l’abus de la banque dans ses réclamations. Les dommages et intérêts pour préjudice moral peuvent compléter votre demande si le comportement de la banque a généré un stress caractérisé ou une atteinte à votre réputation.
| Type de réclamation | Moyen de défense | Délai de prescription |
|---|---|---|
| Créances post-résiliation | Opposer date de résiliation | Non applicable |
| Créances anciennes | Invoquer prescription | 5 ans |
| Défaut d’information | Demander annulation pénalités | 2 ans |
Cette stratégie de défense graduée suppose une connaissance précise de vos droits et des obligations de la banque. Chaque étape doit être documentée : courriers recommandés avec accusé de réception, conservation des réponses de la banque, constitution d’un chronogramme des événements. Cette rigueur documentaire transforme une contestation verbale en argumentation juridique opposable.
La vulnérabilité psychologique liée à l’anxiété financière peut vous pousser à accepter des réclamations injustifiées par crainte d’un contentieux. Pourtant, votre position juridique est souvent bien plus solide qu’il n’y paraît. Les banques misent sur cette méconnaissance pour obtenir des paiements sur des créances prescrites ou éteintes. Votre connaissance du cadre juridique et votre capacité à documenter votre libération partielle constituent vos meilleures protections.
À retenir
- Résiliation et libération ne coïncident jamais : un décalage temporel maintient vos obligations antérieures
- Vices de forme et de fond peuvent invalider votre résiliation, vous laissant totalement engagé
- Capital, intérêts et accessoires nés avant résiliation restent exigibles malgré votre démarche
- Décompte contradictoire et mainlevée formelle sécurisent juridiquement votre statut de libération partielle
- Prescription et défaut d’information constituent vos moyens de défense contre réclamations abusives
La maîtrise de votre libération après résiliation d’un cautionnement bancaire exige une compréhension fine des mécanismes juridiques et une stratégie documentaire rigoureuse. Entre l’illusion d’une libération immédiate et la réalité d’obligations résiduelles complexes, votre sécurisation passe par l’identification précise de ce qui subsiste dans votre périmètre et l’obtention de preuves formelles pour ce qui en est sorti. Cette démarche active transforme l’anxiété liée à l’incertitude en maîtrise juridique complète de votre situation.
Questions fréquentes sur cautionnement bancaire
Dois-je obtenir une attestation de libération après résiliation ?
Oui, il est fortement recommandé d’exiger une mainlevée écrite ou une attestation formelle de libération partielle ou totale de la banque. Ce document officialise votre nouveau statut juridique et vous protège contre des réclamations ultérieures sur des créances qui ne sont plus dans votre périmètre de responsabilité.
Que faire si la banque refuse de fournir un décompte ?
Vous pouvez saisir le médiateur bancaire ou envoyer une mise en demeure par lettre recommandée exigeant le décompte sous 15 jours. Le refus de la banque de communiquer cette information constitue un manquement à ses obligations légales et peut justifier une action judiciaire pour obtenir la communication forcée du document.
Comment vérifier ma radiation du FICP ?
Vous pouvez exercer votre droit d’accès auprès de la Banque de France pour vérifier votre situation et demander la radiation si le prêt est soldé. Cette démarche gratuite s’effectue en ligne sur le site de la Banque de France ou par courrier. Si votre inscription persiste malgré la libération totale de vos obligations, vous pouvez exiger sa suppression immédiate.
La résiliation met-elle fin à toutes mes obligations de caution ?
Non, la résiliation éteint uniquement vos obligations futures. Toutes les créances déjà nées au moment de la résiliation restent intégralement exigibles, incluant le capital restant dû, les intérêts courus et les accessoires de la dette antérieurs à la date de prise d’effet de votre résiliation.